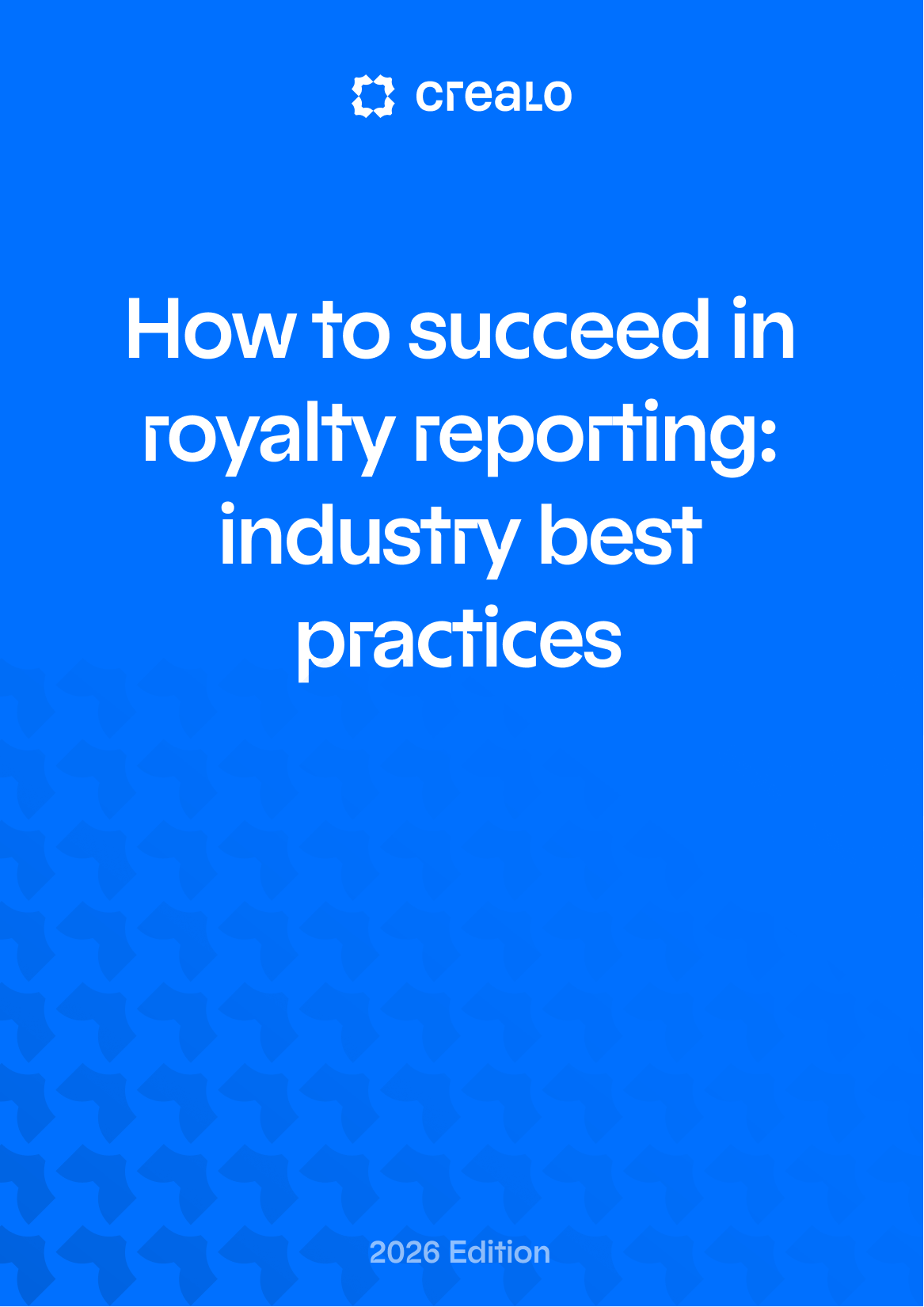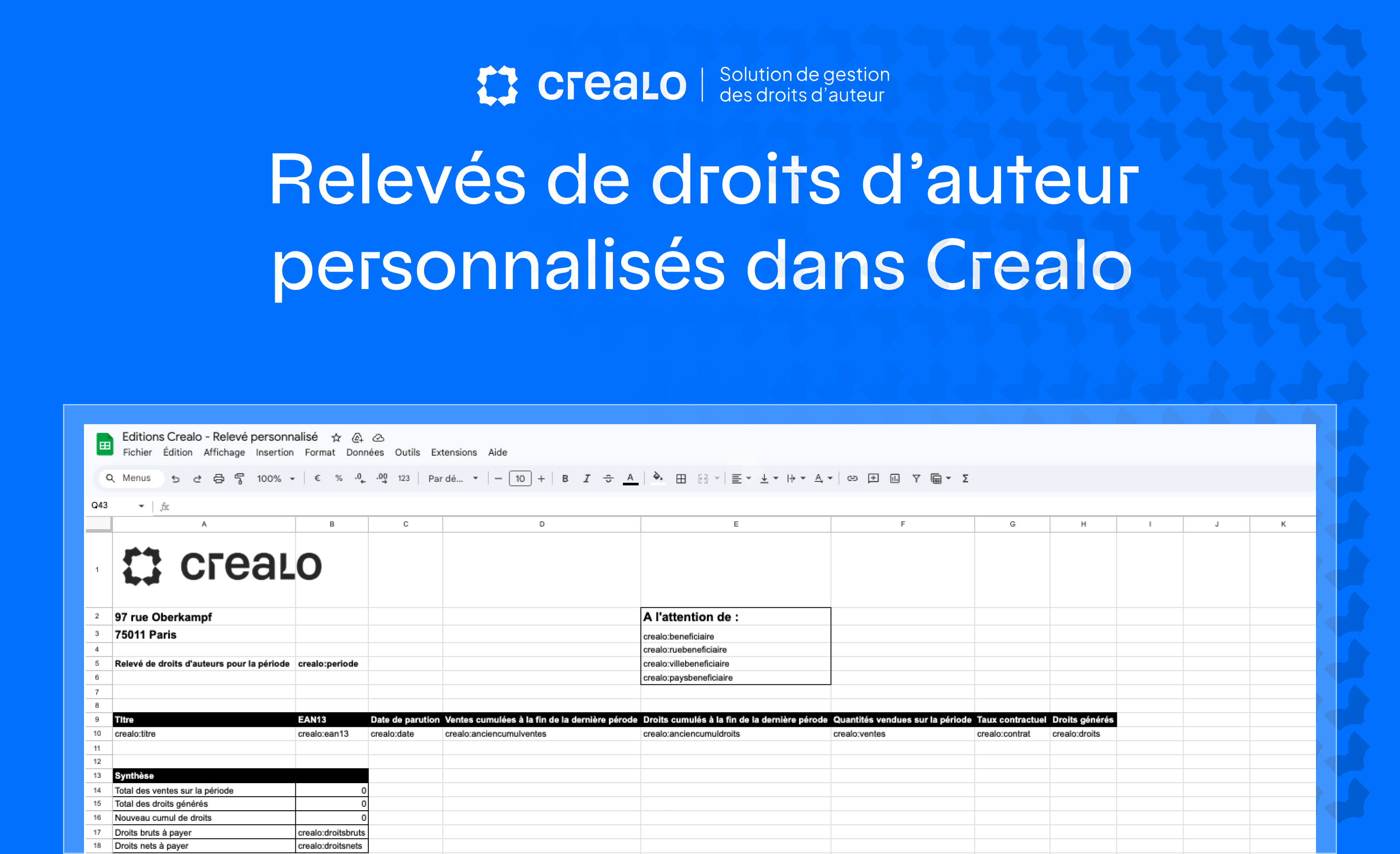Droit d’auteur des journalistes : que permet la loi Hadopi aux éditeurs ?
16/5/25
X min

Droit d’auteur des journalistes : que permet la loi Hadopi aux éditeurs ?
Avec l’essor du numérique, la presse a connu une transformation majeure dans ses modes de diffusion : articles disponibles en ligne, contenus réédités sur application, réseaux sociaux et newsletters.
Les formats se sont multipliés, mais le cadre juridique restait, jusqu’en 2009, calé sur une logique exclusivement papier.
La loi Hadopi, adoptée il y a 16 ans, a profondément réformé le régime des droits d’auteur pour les journalistes.
Son objectif est de permettre aux éditeurs d’exploiter les contenus journalistiques de manière fluide sur tous leurs supports, tout en garantissant aux journalistes la reconnaissance de leur qualité d’auteur et une rémunération adaptée.
Voici dans la suite de cet article l’impact de la loi Hadopi sur le droit d’auteur des journalistes.
Pour en savoir plus sur le droit d’auteur dans la presse, consultez notre article dédié.
Qu’est-ce que la loi Hadopi ?
La loi Hadopi, officiellement appelée loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 encadre la relation juridique entre journalistes et éditeurs.
Elle permet aux entreprises de presse de réutiliser facilement les articles sur tous leurs supports numériques (site web, application, archives, etc.), sans avoir à demander l’autorisation du journaliste ni à lui verser de rémunération supplémentaire à chaque fois.
Ce que change la loi Hadopi pour les éditeurs
Avant 2009, le droit d’auteur interdisait toute réutilisation d’un article de presse sur un support différent sans accord formel de l’auteur.
Résultat : chaque nouvelle diffusion sur le web ou sur une application mobile nécessitait une cession spécifique, complexifiant la gestion éditoriale et freinant la numérisation des contenus.
👉 Depuis la loi Hadopi, les règles ont évolué :
- Les droits patrimoniaux (droits de reproduction, diffusion) sont automatiquement cédés à l’employeur, dès lors que l'œuvre est publiée dans un titre de presse
- Cette cession est exclusive et permet à l’éditeur d’exploiter l’article sur tous les supports liés à la même marque (papier, web, application, formats dérivés…)
- Plus besoin de signer une cession individuelle à chaque rediffusion : un gain de temps considérable pour les services juridiques et les rédactions
⚠️ La cession automatique des droits ne vaut que pour un seul et même titre de presse. Si un article doit être publié dans un autre journal du même groupe, cela nécessite un accord spécifique.
Dès que l’article est utilisé en dehors du journal d’origine (ou d’un ensemble de titres clairement liés), l’autorisation du journaliste devient obligatoire, ainsi qu’une rémunération sous forme de droits d’auteur.
La loi Hadopi introduit aussi une limite dans le temps : les entreprises ne peuvent pas exploiter les articles sans fin. Une fois cette période dépassée, le journaliste doit automatiquement recevoir une rémunération supplémentaire, prévue par les accords collectifs.
Ce que dit la loi Hadopi
Un système à 3 niveaux d’exploitation des articles.

La loi Hadopi a mis en place un mécanisme en trois cercles pour organiser comment un article de journaliste salarié peut être réutilisé par une entreprise de presse. Cela encadre la cession automatique des droits et définit ce qui est inclus dans le salaire du journaliste… et ce qui doit être rémunéré en plus.
1er cercle : la réutilisation dans le même titre de presse
Exemple : Le Monde publie un article dans sa version papier, puis le reprend sur son site internet ou son application mobile
- L’article appartient à l’employeur (le journal), dès qu’il est écrit par le journaliste dans le cadre de son travail
- L’entreprise peut le republier sur tous ses supports (papier, web, archives, newsletter…) sans demander d’autorisation ni verser de rémunération en plus
- Cette règle est valable pendant une période définie (appelée « période de référence »), fixée par accord collectif
- Pendant cette période, le journaliste est uniquement payé via son salaire
2e cercle : la réutilisation dans un autre titre de la même famille de presse
Par exemple, un article de Télérama repris dans La Vie ou Le Monde des Ados, s’ils font partie du même groupe média. Ici, l’article sort de son média d’origine, mais reste dans le même groupe éditorial.
Pour ce type de réutilisation, il faut :
- L’accord du journaliste, sauf si un accord collectif le prévoit
- Et une rémunération supplémentaire, qui peut être intégrée au salaire ou versée en droits d’auteur
3e cercle : toute autre exploitation
- Article repris dans un autre groupe de presse (hors famille éditoriale)
- Réutilisation de l’article après la fin de la période de référence
- Dans ce cas, l’article ne peut être exploité qu’avec l’accord explicite du journaliste
- Il doit recevoir une rémunération complémentaire, obligatoirement définie dans un accord collectif
- Cette rémunération peut être un salaire ou des droits d’auteur, mais dans tous les cas, les conditions doivent être claires : durée, étendue des droits cédés, montant forfaitaire ou proportionnel
Les droits d’auteur que conservent les journalistes
La réforme Hadopi ne dépossède pas le journaliste de ses droits fondamentaux. Le journaliste conserve :
- Son statut d’auteur et son droit moral (paternité, respect de l’intégrité de l’œuvre)
- Le droit de publier un recueil de ses articles, à condition que cela ne concurrence pas directement le média d’origine
- Le droit à une rémunération appropriée pour l’ensemble des exploitations de ses œuvres, y compris sur les nouveaux supports numériques
💡 Bon à savoir : la rémunération peut être intégrée au contrat de travail (via une clause forfaitaire ou proportionnelle).
Et les autres exploitations (copies, revues de presse, reventes…) ?
En dehors de l’exploitation éditoriale par le titre de presse lui-même, on parle de droits secondaires (ou droits dérivés).
Ces usages concernent par exemple :
- Les panoramas de presse
- La revente d’articles à des bases documentaires ou plateformes de veille
- Les utilisations audiovisuelles, commerciales ou promotionnelles
Ces droits sont généralement gérés de deux façons :
- Via des sociétés de gestion collective (SCAM, CFC, SAIF…), qui collectent les droits auprès des exploitants et les redistribuent aux journalistes
- Par contrat spécifique entre l’éditeur et le journaliste, si l’usage est ponctuel ou hors cadre collectif
Récapitulatif pour les éditeurs
Besoin d’un accompagnement pour votre gestion des droits d’auteur ?
👋 Notre logiciel de gestion des droits d'auteur pour les groupes de presse vous permet d'automatiser la gestion des droits des journalistes. Des groupes comme Beaux Arts Magazine, LE UN HEBDO et L'Équipe nous font déjà confiance et utilisent notre solution de gestion des droits d'auteur pour gérer efficacement les droits liés à leurs parutions.
Contactez-nous pour en savoir plus.
FAQ droits d’auteur pour les journalistes
Existe-t-il des droits d’auteur pour les journalistes ?
Oui. Les journalistes salariés sont considérés comme auteurs de leurs articles. Ils bénéficient à ce titre d’un droit moral inaliénable (paternité, respect de l’intégrité de l’œuvre) et de droits patrimoniaux, cédés automatiquement à leur employeur uniquement dans certaines conditions encadrées par la loi Hadopi.
Que prévoit la loi Hadopi pour les droits d’auteur des journalistes ?
La loi Hadopi (2009) encadre la cession automatique des droits d’exploitation des journalistes salariés à leur employeur, pour permettre la réutilisation fluide de leurs articles sur l’ensemble des supports d’un même titre de presse (papier, site web, appli mobile, newsletter, archives, etc.), sans autorisation préalable ni rémunération supplémentaire pendant une période déterminée.
L’éditeur de presse peut-il republier un article sur tous ses canaux ?
Oui, à condition que cela reste dans le cadre du même titre de presse.
Quels sont les trois niveaux d’exploitation définis par la loi Hadopi ?
- Premier cercle : exploitation dans le même titre de presse. Pas d’autorisation ni rémunération supplémentaire requises pendant la période de référence
- Deuxième cercle : exploitation dans un autre titre du même groupe de presse. Autorisation et rémunération supplémentaires requises, sauf disposition contraire dans un accord collectif
- Troisième cercle : exploitation hors groupe ou après la période de référence. Accord explicite et rémunération complémentaire obligatoires
Qu’est-ce que la “période de référence” ?
C’est la durée pendant laquelle l’éditeur peut réutiliser librement un article dans le cadre du même titre. Elle est définie par accord collectif. Au-delà de cette période, une rémunération supplémentaire est due au journaliste.
Quels sont les avantages de la loi Hadopi pour les éditeurs de presse?
- Une gestion simplifiée de la republication multi-supports,
- Moins de formalités administratives,
- Une sécurisation juridique pour la réutilisation numérique,
Si un article est réutilisé dans un autre titre du groupe de presse, le journaliste perçoit-il des droits d’auteur ?
Oui. Dès qu’un article sort de son média d’origine, même s’il reste dans le même groupe éditorial, le journaliste doit être rémunéré spécifiquement.
Cette rémunération peut prendre la forme soit d’un complément de salaire, soit de droits d’auteur, définis dans un accord collectif ou un contrat individuel.
Les photographes et les pigistes sont-ils concernés par la loi Hadopi ?
Non, pas automatiquement.
La loi Hadopi ne s’applique qu’aux journalistes salariés en CDI dans une entreprise de presse. Les pigistes (journalistes non salariés) et les photographes indépendants ne cèdent leurs droits que selon les termes du contrat signé avec le journal. Il est donc essentiel de formaliser chaque usage dans un contrat clair et précis, notamment pour les réutilisations numériques.
Qu’en est-il des photographes salariés ?
Oui, les photographes salariés bénéficient des mêmes dispositions que les journalistes salariés.
Cela signifie que leurs photos sont automatiquement cessibles à leur employeur, pour tous les usages liés au même titre de presse (print, web, appli, archives…). Pas besoin d’un contrat spécifique pour chaque rediffusion dans le périmètre du titre.